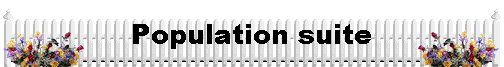|
3.3 Institutions et vie politique
Congrès du Parti communiste chinois Forrest Anderson/Liaison Agency
Le régime chinois est une démocratie populaire à parti unique et d’inspiration marxiste-léniniste. L’avènement de la République populaire en 1949 a introduit un changement profond dans les institutions. Depuis, le pays a élaboré quatre Constitutions. La première (1954), calquée sur la Constitution de l’URSS de 1936, fut la plus stalinienne et la plus totalitaire. Deux autres lui succédèrent en 1975 et 1978. En 1982, une nouvelle Constitution fut acceptée, plus conforme aux nouvelles orientations du régime, et comportant 138 articles répartis en 4 chapitres. Néanmoins, son préambule indique que le régime politique de la Chine reste une dictature du prolétariat conduite par le Parti communiste et reposant sur un front uni pouvant inclure des partis démocratiques.
3.3.1 Pouvoir exécutif
Le président de la République remplit une fonction purement symbolique. Mais, en théorie, il peut légiférer, nommer ou renvoyer de hauts fonctionnaires, ratifier ou contester des accords passés avec des pays étrangers. Il est assisté d’un vice-président et est élu pour cinq ans par l’Assemblée nationale populaire (ANP).
Le pouvoir exécutif est entre les mains du Conseil des affaires d’État, c’est-à-dire la plus haute autorité du gouvernement. Ce Conseil régit différents ministères et commissions. Il est responsable devant l’ANP et son Comité permanent, dont il applique les lois et les résolutions. Il prend des mesures administratives, élabore des lois et des règlements, et émet des ordonnances. Il est dirigé par le Premier ministre et se compose des vice-Premiers ministres, des ministres, des présidents de commissions, du président de la commission des Comptes et d’un secrétaire général.
Le commandement des affaires militaires nationales relève de la Commission militaire centrale.
Généralement, les charges les plus importantes dans la conduite des affaires politiques sont les postes de Premier ministre et de secrétaire général du Parti. Mais l’autorité qui leur est conférée dépend largement des personnalités qui les occupent. Au début des années quatre-vingt-dix, le personnage le plus puissant du gouvernement a été Deng Xiaoping, qui, bien que ne détenant plus aucun poste officiel depuis 1989, est resté l’arbitre du régime jusqu’à sa mort en février 1997.
3.3.2 Pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est détenu par l’Assemblée nationale populaire. Ses membres sont élus pour cinq ans au suffrage indirect. Les provinces désignent leurs députés, dans une proportion de 1 député pour 400 000 personnes, avec un minimum de 10 députés pour chaque province.
La Ve Assemblée (1978-1983) comptait 3 497 députés, dont environ la moitié étaient des ouvriers ou des paysans, et la VIe Assemblée (1983-1988) 2 978. La VIIIe Assemblée (1993-1998) totalise également 2 978 députés comprenant 11,15 p. 100 d’ouvriers, 9,4 p. 100 de paysans, 21,79 p. 100 d’intellectuels, 28,27 p. 100 de cadres, 19,21 p. 100 de sans-parti ou représentant des partis démocratiques, 8,79 p. 100 de militaires, 1,21 p. 100 de Chinois d’outre-mer revenus au pays. Les femmes y sont représentées à 21,02 p. 100 et les 55 minorités ethniques à 14,74 p. 100.
L’ANP vote les lois, amende la Constitution, approuve le budget national et les plans économiques. Elle a également le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du Conseil des affaires d’État et de la Commission militaire centrale, le président de la Cour populaire suprême et le procureur du Parquet populaire suprême.
Dans la réalité, l’ANP dispose de peu de pouvoir effectif. En raison de sa taille, elle ne se réunit qu’une fois par an pour régler les affaires importantes. Durant l’intersession, un Comité permanent, élu par les députés et dans lequel figurent également le président et les vice-présidents de l’Assemblée, la remplace, la représente et peut ratifier ou abroger des traités passés avec des gouvernements étrangers.
3.3.3 Pouvoir judiciaire
La tradition judiciaire chinoise est fondamentalement différente de celle des nations occidentales. Le droit a toujours eu pour fonction de défendre l’ordre public et non de garantir les droits de l’individu. Néanmoins, depuis la Constitution de 1978, la Chine a commencé à aligner ses institutions judiciaires sur les modèles occidentaux. La Constitution de 1982 garantit désormais un droit de défense juridique et les libertés de chacun. Interrompues depuis des années, les professions d’avocat et de notaire connaissent de ce fait un nouvel essor, même si leur rôle est encore mal accepté.
Le système judiciaire chinois est articulé autour de trois éléments : les tribunaux, la Sécurité publique (police) et le parquet.
L’organe supérieur est la Cour populaire suprême, qui veille à l’observation de la Constitution et juge en dernier ressort. Elle est chargée de contrôler les tribunaux populaires locaux ou spéciaux et le tribunal militaire. Elle est responsable devant l’ANP et son Comité permanent.
Les tribunaux populaires sont les organes judiciaires locaux. Ils figurent dans les provinces, les régions autonomes, les municipalités et se répartissent en trois échelons : district, préfecture et province. Les procès y sont publics, sauf ceux concernant les secrets d’État ou les mineurs.
Les parquets populaires sont des instances indépendantes. Ils se chargent du contrôle juridique et fonctionnent parallèlement aux tribunaux populaires. Le Parquet populaire suprême est dirigé par un procureur général. Le domaine d’intervention des parquets est la sécurité du territoire et les affaires criminelles. Les parquets populaires veillent également à l’application scrupuleuse de la loi au sein des tribunaux populaires ou encore aux conditions pénitentiaires et au respect des procédures de la Sécurité publique.
La Sécurité publique, omnipotente sous Mao Zedong, a vu ses pouvoirs discrétionnaires limités. Néanmoins, la détention administrative dans les laogai, les camps de rééducation par le travail (sans jugement et en principe limitée à quatre ans), et dans les maisons de détention (réservées à l’exécution des peines de courte durée) sont toujours sous son contrôle, ce qui lui permet d’arrêter tout suspect sans aucune procédure judiciaire.
3.3.4 Gouvernement local
En Chine, le système politique repose, à la base, sur les structures locales présentes dans l’ensemble des circonscriptions à l’échelon des provinces, des régions autonomes, des municipalités, des districts et des cantons. Leurs membres sont élus par la population.
Les assemblées populaires locales sont les ramifications de l’ANP. Au-dessus de l’échelon du district, elles peuvent instituer des comités permanents. Aux échelons les plus hauts (provinces, régions autonomes, municipalités), elles ont le droit de statuer sur des affaires importantes et de procéder à des règlements.
Les gouvernements populaires locaux sont placés sous la tutelle du Conseil des affaires d’État. Ils ont pour tâche de contrôler le travail administratif de leur territoire. Chacun doit rendre compte de ses résultats à l’assemblée populaire de même échelon, et à l’organe administratif de l’État qui lui est immédiatement supérieur.
3.3.5 Partis politiques
Même si le préambule de la Constitution ne fait plus référence au rôle dirigeant du Parti communiste, celui-ci le conserve de fait, l’imbrication de l’appareil d’État et de l’appareil du Parti s’observant encore à tous les échelons.
Le Parti communiste chinois compte plus de 54 millions d’adhérents (environ 4,4 p. 100 de la population). Lors de son Ier Congrès national en 1921, il ne réunissait que 57 membres contre 10 millions en 1956. Le Congrès national est l’organe suprême du Parti. Le Comité central, élu par le Congrès national, désigne le Bureau politique et son comité permanent qui détiennent le contrôle réel de l’appareil, ainsi que le secrétaire général du Parti.
Il existe également huit autres formations politiques appelées « partis démocratiques ». Le Comité révolutionnaire du Guomindang de Chine (1948) rassemble 47 000 adhérents et la Ligue démocratique de Chine (1941), 117 000 membres (intellectuels, couches supérieures et moyennes de la population). L’Association pour la construction démocratique de la Chine (1945) comprend 61 000 membres issus des milieux économiques. L’Association chinoise pour la démocratie (1945) recense 56 000 adhérents (milieux de l’éducation, de la culture, de la science et de l’édition). Le Parti démocratique paysan et ouvrier de Chine (1938) compte 55 000 adhérents (milieux de l’éducation, de la culture, de la science et de la médecine). Le Zhi Gong Dang de Chine (1925) rassemble 13 000 membres, principalement des Chinois émigrés (Chinois d’outre-mer) revenus au pays. La Société Jiu San (1944) compte 57 000 adhérents appartenant à l’élite intellectuelle (sciences, technologie, culture, éducation, médecine). Enfin, la minuscule Ligue pour l’autonomie démocratique de Taïwan (1 400 adhérents), fondée en 1947, se compose de Taïwanais installés en Chine.
D’autres structures, dites groupements sociaux, participent à la vie du pays. La Fédération des Syndicats de Chine (1925), le plus gros organe syndical, rassemble 101,76 millions de syndiqués. La Fédération nationale de la jeunesse de Chine (1949) regroupe 13 organisations, dont la Ligue de la jeunesse communiste (1922) et ses 56,8 millions de jeunes. La Fédération nationale des femmes de Chine (1949) se charge de protéger les droits et les intérêts des Chinoises, renforcés par une loi adoptée en 1992. Pékin a récemment organisé la IVe Conférence mondiale des femmes en septembre 1995, à l’occasion de laquelle des Tibétaines se sont montrées au monde entier volontairement bâillonnées, afin de protester et d’alerter l’opinion sur les traitements qui leur sont infligés. À noter encore la Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine (1953) et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger (1954).
3.3.6 Défense nationale
La Constitution de 1982 confère le commandement des forces armées à la Commission militaire centrale. Les forces militaires du pays sont constituées par l’Armée populaire de libération (APL), dont l’appellation date de 1946, ainsi que par la police armée et la milice populaire.
L’APL comporte trois armées composées de militaires de carrière et d’appelés (service de 36 à 48 mois). Avec 2 millions d’hommes et 1,2 million de réservistes en 2001, elle est numériquement la première armée du monde. La marine compte 250 000 hommes et 972 bâtiments de toutes tailles, dont 50 sous-marins. L’armée de l’air représente 420 000 hommes et 4 970 chasseurs. L’armée de terre comprend 2 millions d’hommes, 14 500 pièces d’artillerie et près de 8 000 chars de combat. La Chine possède également l’arme nucléaire.
Aux moments les plus chaotiques de la Grande Révolution culturelle prolétarienne, l’APL demeura la seule force organisée et fut utilisée pour mettre fin au mouvement. C’est également elle qui fut chargée de réprimer le mouvement démocratique de juin 1989 à Pékin. Elle constitue toujours une institution déterminante et les gouvernants restent en permanence sensibles à ses réactions. En 2000, le budget de la Défense représentait 5,3 p. 100 du produit intérieur brut (PIB) contre 7,9 p. 100 en 1985. Bien que ses effectifs aient baissé de 1 million d’hommes en dix ans, l’APL possède un pouvoir économique conséquent (25 millions de salariés, 50 000 usines, hôtels, hôpitaux, etc.). Son bénéfice annuel serait de 5 à 10 milliards de dollars. Cet empire financier lui permet de peser lourdement dans le jeu politique de la Chine.
3.4 Langues et religions
3.4.1 Langues
Les Chinois possèdent une écriture depuis plus de trois mille ans, et bien qu’il existe plus d’une douzaine de dialectes, les caractères restent les mêmes partout en Chine. Cette unité scripturale a joué un rôle déterminant dans l’unité historique du peuple chinois depuis la dynastie Shang (XVIe-XIVe siècle av. J.-C.).
La langue officielle est le putonghua (« langue commune »), appelée plus communément chinois mandarin en Occident, et qui est en fait la langue parlée en Chine du Nord. Le chinois est la langue la plus parlée au monde avant l’anglais et l’espagnol. Appartenant à la famille linguistique sino-tibétaine, la langue chinoise possède de nombreuses variantes orales, notamment dans le Sud où l’on parle fréquemment le chinois cantonais. En 1955, elle fut déclarée langue commune à la Conférence nationale pour la réforme de la langue écrite. Elle comprend, selon le niveau de langage, de 10 000 à 50 000 caractères, dont 6 000 sont utilisés couramment et dont 2 400 servent uniquement dans la vie quotidienne. On a cherché à simplifier l’écriture afin de lutter contre l’analphabétisme (fixée à moins de 500 caractères). C’est pourquoi certains caractères présentent aujourd’hui moins de traits, ou sont plus proches d’une écriture cursive. Les principaux autres dialectes chinois sont le wu, le xiang, le yue, le min, le kejia ou encore le gan.
En 1977, la République populaire demanda officiellement aux Nations unies d’utiliser le système de romanisation hanyu pinyin (littéralement « transcription phonétique du chinois ») pour les noms de lieux. Ce système, créé à la fin des années cinquante, a été modifié à plusieurs reprises.
Environ 100 millions de Chinois pratiquent les 55 langues des minorités nationales (miao-tseu, tibétain, thaï, lolo, mongol, etc.). Le gouvernement chinois a encouragé le développement des formes écrites de ces langues à l’aide du pinyin. Le mandarin est néanmoins enseigné dans les écoles, généralement comme deuxième langue, et sa connaissance est exigée dans toute la Chine.
3.4.2 Religions
Temple bouddhique (Chine) Situé dans le Sichuan, ce temple est dédié à Guanyin, divinité bouddhique de la compassion. Introduit sous la dynastie Han, au Ier siècle apr. J.-C., par le biais de la route de la Soie, le bouddhisme est aujourd'hui la « voie spirituelle » la plus influente en Chine.
La Chine compte plus de 100 millions de croyants. Il n’y a pas à proprement parler de religion officielle, mais trois « voies spirituelles » dominent pourtant : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme.
Le confucianisme, discipline morale née au VIe siècle av. J.-C., fut vilipendé par Mao Zedong en 1973. Il a, depuis, retrouvé une place dans la pensée chinoise.
Le taoïsme a pris racine dans la population han vers le IIe siècle. L’ermitage des Nuages blancs (Pékin), le palais Qingyang (Chengdu), le palais Taiqong (Shenyang) en sont les temples les plus célèbres.
C’est aujourd’hui le bouddhisme, introduit au Ier siècle, qui exerce la plus forte influence en Chine. Le bouddhisme dit Hinayana (ou « Petit Véhicule ») est pratiqué par certaines minorités (Dais, Bulangs, De’angs, etc.). Les plus célèbres sanctuaires sont le temple du Cheval blanc (Luoyang), Lingyin (Hangzhou), Shaolin (Henan) et le monastère de la Grande Bienfaisance (Xi'an). Le bouddhisme lamaïque (Tibétains, Mongols, Luobas, Menbas, Tus, Yugurs) est pratiqué dans de nombreux monastères (Jokhang, Sagya et Tashilunpo au Tibet ; Ta’er au Qinghai ; temple des Lamas Yonghegons à Pékin).
Apparu en Chine au VIIe siècle, l’islam est pratiqué ouvertement par dix minorités nationales (Huis, Ouïgours, Kazakhs, Kirghiz, Tatars, Ouzbeks, Tadjiks, Dongxiangs, Salars, Bao’ans) et compte une vingtaine de millions d’adeptes. À noter les mosquées de la Grue (Yangzhou), de Huajue (Xi’an), de Niujie (Pékin), de Dongba (Yinchuan) ou encore d’Idkah (Xinjiang).
Le catholicisme rassemble 4 millions de pratiquants, notamment dans le Sud, parmi lesquels de nombreux Miaos, des Yaos et des Yis. Le protestantisme concerne également 3 millions de Chinois. Ces deux religions, moins influentes que le bouddhisme et l’islam, furent surtout propagées dans les grandes villes (Shanghai, Pékin, etc.).
L’une des premières mesures du Parti communiste chinois, en 1949, fut de bannir les cultes. Tous les lieux de culte furent fermés pendant la Révolution culturelle et les moines bouddhistes rééduqués par le travail dans les champs. Il fallut attendre la nouvelle Constitution de 1982 et son article 88 pour que la liberté de culte soit garantie. Cependant, des inégalités persistent. Le bouddhisme tibétain, qualifié de « secte » par les documents officiels, est étouffé. Le futur panchen-lama a été enlevé et se trouve séquestré quelque part dans le pays. Les catholiques dont la plupart sont restés fidèles au Vatican, ne possèdent pas encore d’église propre et ne se reconnaissent pas dans celle qu’a imposée le Parti communiste en 1957, l’Association catholique patriotique chinoise. |
|